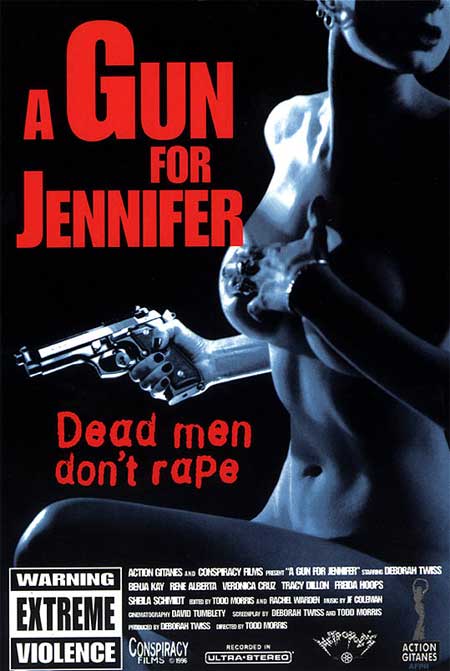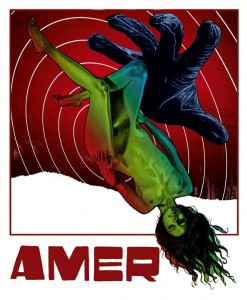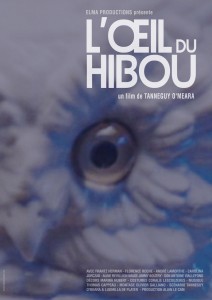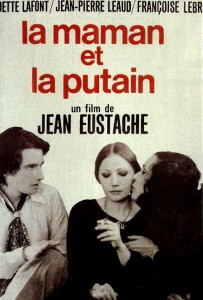Koji Wakamatsu naît au Japon en 1936, il y meurt en 2012. Il est issu d’une famille paysanne pauvre. A dix-huit ans, il quitte la ferme et son village natal pour se rendre à Tokyo. Il y travaille d’abord comme apprenti pâtissier mais suite à une bagarre avec un collègue, il démissionne. Il enchaîne alors les petits boulots, devient livreur de journaux, travaille dans un atelier de confection de biscuits – d’où il démissionne également, révolté par les conditions de travail – puis sur des chantiers, avant de rejoindre un clan de yakuzas dans le quartier de Shinjuku. Il passe cinq mois en maison d’arrêt. Insoumis devant l’attitude des gardiens, on le transfère au quartier disciplinaire. A sa sortie de prison, il recontacte un producteur pour qui il avait travaillé comme agent de sécurité sur des plateaux de tournage, et obtient un poste d’assistant de production pour la télévision.
Ces quelques lignes biographiques inscrivent d’emblée la trajectoire de Wakamatsu du côté de la révolte. Révolte contre les inégalités sociales, directement vécues, révolte contre l’autorité et ses symboles. Son rapport au cinéma y sera profondément lié :
(…) Je ne pouvais toujours pas accepter de voir fanfaronner les policiers en uniforme. J’eus l’envie d’écrire un roman pour me venger, mais au bout de dix pages je n’avais déjà plus rien à raconter. Je pensai alors au cinéma. J’étais loin de vouloir devenir réalisateur, mais l’idée était de gagner suffisamment d’argent pour produire un film dans lequel les flics crèveraient à la pelle. (1)
Wakamatsu travaille donc comme assistant de production, jusqu’à ce que l’agent d’un acteur lui propose de réaliser lui-même un film. Il refuse d’abord, on le convainc, et il tourne ainsi son premier film, Doux piège, en 1963, avec pour seule contrainte de « montrer quelques filles nues ». Le film – l’histoire de deux détenus qui prennent la fuite lors d’un transfert – est un succès, les propositions s’enchaînent et c’est ainsi que la carrière de réalisateur de Wakamatsu est lancée, se situant d’emblée dans le genre « pinku eiga », cinéma érotique japonais alors en train de naître.
Ce cinéma pink est souvent assez soft, se contentant de montrer quelques filles dénudées, sans que la dimension érotique soit forcément centrale dans les films. Il est aussi soumis au tabou très fort de la pilosité, aussi les parties génitales ne sont-elles jamais montrées. Wakamatsu sera considéré comme l’un des chefs de file du pinku eiga, mais si ses films répondent aux exigences d’un cinéma d’exploitation réclamant son quota d’érotisme et de violence et diffusé essentiellement dans les petites salles spécialisées, il saura manier ce cinéma comme une arme, se revendiquant « cinéaste activiste », et créant d’une certaine façon le pinku politique.
En 1965, Wakamatsu fonde sa société de production, la Wakamatsu Production. La même année, il réalise Les Secrets derrière le mur, qu’il considère comme son premier film personnel, et qui est la première réalisation de la Wakamatsu Production en tant que sous-traitant. A partir du film suivant, Quand l’embryon part braconner, sa société produit seule ses films et il réalise en totale indépendance.
Commence alors une longue période extrêmement prolifique. Durant les années soixante et soixante-dix, il aura réalisé une centaine de films, trente-sept entre 1966 et 1969, soit une dizaine par an, souvent tournés en quatre ou cinq jours, avec peu de préparation et un budget restreint, dans une démarche proche du DIY.
Malgré ce rythme de production et le peu de moyens dont il dispose, ce qui frappe d’emblée dans les films de Wakamatsu, c’est la composition extrêmement soignée de chaque plan. Ils appartiennent au cinéma d’exploitation mais se rapprochent aussi d’un cinéma qu’on pourrait qualifier d’avant-garde, influencé par la Nouvelle Vague et multipliant les expérimentations formelles.
1971 marque une date importante dans la carrière de Wakamatsu puisque deux de ses films, Les Anges violés et Sex Jack, sont projetés à la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes.
En 1976, il est producteur exécutif sur L’Empire des sens de Nagisa Oshima dont il est aussi co-scénariste.
Dans les années 80 il abandonne le pinku eiga, devenu à ses yeux un genre trop « respectable », revendiquant un cinéma réellement underground :
(…) le cinéma pink doit rester dans l’ombre. Ce genre de trucs se tourne et se regarde en cachette, voilà pourquoi je parle de guérilla. Pourtant des critiques sans cervelle ont chanté les louanges des pinku eiga et celui-ci a fini par acquérir de la respectabilité. Depuis, ça ne m’intéresse plus. Ces foutus films, je pourrais les tourner même les yeux fermés. Mais quand c’est un type sans aucune ambition qui s’y colle, ça n’a aucun intérêt. Il y a sans doute dans le lot quelques réalisateurs qui font de bons films, mais le genre a été fini à partir du moment où tout le monde s’est mis à en faire l’éloge. Le pink doit rester dans l’ombre et c’est au milieu du mépris et des insultes que naissent des œuvres de qualité. C’est dans ces conditions qu’on peut tout oser et réaliser des films extravagants. (2)
La dimension politique des films de Wakamatsu, au-delà du mode de fabrication lui-même, est souvent explicite dans leurs sujets. Les personnages de militants politiques y sont nombreux, comme le groupe de jeunes révolutionnaires de Sex Jack, l’ancien activiste mis sur écoute dans La Saison de la terreur, ou les groupuscules d’extrême-gauche qui s’entredéchirent dans L’Extase des anges. Dans Running in madness, dying in love, le récit d’une passion amoureuse s’ancre dans un contexte de révolte politique, le film s’ouvrant sur des images d’affrontement entre la police et des manifestants, puis sur l’altercation entre un militant et son frère policier. La femme du policier tue accidentellement son mari, puis s’enfuie avec l’activiste qui devient son amant.
Dans tous ces films, énergie sexuelle et élan révolutionnaire sont profondément liés. Dans Sex Jack, le groupe d’étudiants activistes réfugiés dans un appartement copulent sauvagement en scandant des slogans révolutionnaires. Dans La Saison de la terreur, l’ancien militant a délaissé le combat politique pour une vie de débauche, la pulsion sexuelle venant d’une certaine façon compenser l’inaction militante. Dans Running in madness, si l’intrigue amoureuse se développe par la suite de façon autonome sans plus se référer à des revendications militantes, la passion charnelle prend corps dans un contexte de lutte politique et d’opposition au pouvoir.
En 1971, Wakamatsu réalise Armée rouge/FPLP : Déclaration de guerre mondiale, sur les mouvements de résistance palestiniens. Il tourne dans différents camps d’entraînement au Liban, en Syrie et en Jordanie, partageant la vie quotidienne de ces commandos. C’est une expérience décisive dans le parcours de Wakamatsu, et c’est l’année suivante qu’il réalise L’Extase des anges, son film pink le plus directement politique.
L’un de ses derniers films datant de 2007, United Red Army, décrit la création du groupuscule d’extrême-gauche japonais, l’Armée rouge unifiée, le régime de terreur que certains de ses membres instaurèrent peu à peu à l’intérieur du groupe puis son arrestation par les forces de l’ordre.
Dans de nombreux films des années soixante et soixante-dix, Wakamatsu met en scène l’oppression politique et sexuelle des femmes. « La libération de l’homme ne passera jamais par l’asservissement de la femme », voilà le discours sous-jacent de ces films, tel que le formule Jean-Pierre Bouyxou dans la préface au film Violence sans raison, dans l’un des quatre coffrets DVD édités par Blaq Out en 2010 et regroupant une quinzaine de films du cinéaste.
Dans certains films, les femmes victimes de la domination masculine y deviennent les représentantes du peuple face au pouvoir. C’est explicite dans son premier film indépendant, Quand l’embryon part braconner, dans lequel un chef de rayon, à la suite d’un flirt avec l’une de ses employées, la séquestre et la torture. La symbolique est évidente, le rapport d’asservissement d’ordre sexuel se développe à partir d’un rapport de domination patron/employée déjà existant.
Comme beaucoup de films de Wakamatsu, Quand l’embryon part braconner se présente sous la forme d’un huis-clos oppressant, et comme souvent aussi, l’idée du film naît du décor. En 1966, pendant une période de pluies fréquentes rendant difficile un tournage en extérieurs, Wakamatsu, pour des raisons d’abord économiques, a l’idée de tourner un film entièrement dans son appartement. C’est à partir du lieu que lui vient l’idée du film. Il fait alors appel à Masao Adachi, scénariste d’extrême-gauche avec qui il travaille régulièrement. Le film sera tourné en cinq jours, pendant lesquels Wakamatsu impose à son équipe de rester enfermée, comme ses personnages, à l’intérieur de l’appartement.
Le personnage masculin est obsédé par le fantasme du retour au ventre maternel, à l’état de fœtus, le film s’ouvrant sur une citation du livre de Job : « Périsse le jour où je suis né. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? ». Il est aussi obsédé par deux femmes que son employée lui rappelle : sa mère suicidée et son ex-femme qui l’a quitté, enceinte d’un autre parce qu’il ne voulait pas enfanter à son tour. Comme les personnages de voyeurs récurrents chez Wakamatsu – celui des Secrets derrière le mur, qui épie ses voisins au moyen d’une longue-vue et que le regard des femmes rend impuissant, ou celui des Anges violés, qui ne parvient lui aussi à sortir de son impuissance que par l’assassinat – il est incapable d’une relation sexuelle normale, incapable de jouir sans recourir à la violence, les coups de fouet se substituant à l’acte sexuel.
Face à lui, un personnage de femme insoumise. Elle refuse de se laisser acheter par son patron qui lui propose de l’argent, se révolte et se libère en assassinant son tortionnaire. Mais au-delà des violences infligées par cet homme, c’est plus largement de son statut de femme et d’employée, dans une société patriarcale et capitaliste, qu’elle prend conscience.
Incompris, le film fait scandale au festival du film expérimental de Knokke-le-Zoute en Belgique, où des spectateurs, jugeant qu’il dégrade la femme, manifestent devant l’écran. Il ne sortira en France qu’en 2007, subissant une interdiction aux moins de dix-huit ans.
L’année précédente, en 1965, Wakamatsu, sollicité par une société de production mais ne disposant que d’un budget restreint, avait inscrit l’action des Secrets derrière le mur à l’intérieur d’une cité HLM, et principalement de deux appartements. L’idée du film était née là aussi du lieu, de ces cités-dortoirs modernes aux formes identiques, des vies étriquées dans ces grands ensembles.
Le personnage principal, Makoto, un jeune étudiant, passe le plus clair de son temps à observer ses voisins à l’aide d’une longue vue. Cette configuration et le thème du voyeurisme qui s’y rattache renvoient à un certain nombre de films construits sur le même schéma : on pense évidemment au Fenêtre sur cour d’Hitchcock, réalisé en 55, et au film de Kieslowski, Brève histoire d’amour, réalisé en 88.
Makoto épie. Une femme, en particulier, qui reçoit régulièrement son amant, ancien militant communiste qui maintenant boursicote, en cachette de son mari. Une autre femme aussi, qui vit seule et a pour habitude de laisser tomber ses sous-vêtements sur le balcon de la première, tentant désespérément d’établir un contact. La profonde solitude de la vie moderne et son manque d’horizon, symbolisés autant que fabriqués par le paysage carcéral de cité-dortoir, l’évolution des personnages entre leurs quatre murs et ces tentatives ratées de créer du lien sont le propos central du film.
Makoto l’étudiant ne peut jouir des femmes qu’à distance, protégé par un instrument. Le sexe n’est pas déconnecté du politique, pour preuve certains symboles très appuyés : lorsque Makato se masturbe devant des photos érotiques que jouxte un article de presse sur les politiciens corrompus, ou lorsque le couple fait l’amour devant un portrait de Staline. Ce couple symbolise la fin des idéaux communistes et la résignation.
Le personnage de la femme infidèle, Mme Yamabé, représente les humiliations et les aspirations des femmes du Japon des années 60. Elle désire profondément travailler mais son mari ne l’y autorise pas, et se trouve malgré elle confinée à l’espace domestique. La passion qu’elle voue à son amant n’est pas même une échappatoire tant elle est tournée vers le passé et ses échecs (celui de la révolution et du communisme), marquée par la guerre (la femme se complait à caresser la cicatrice de l’homme, stigmate d’Hiroshima, symbole de leurs idéaux pacifistes) et empreinte d’une forme de culpabilité (l’ancien militant communiste opposé à la guerre joue en bourse, s’enrichissant grâce à la guerre du Viêt Nam).
Parallèlement à la claustration subie de la femme, il y a l’enfermement volontaire de Makoto, qui délaisse ses études malgré les remontrances de sa famille, et se complait à vivre ses désirs par procuration, à distance, en convoquant un ailleurs fantasmé. Hormis sa mère qu’on voit peu, la seule femme qu’il côtoie est sa sœur, à l’égard de qui l’attitude de Makoto se réduit à une curiosité un peu malsaine et méprisante. Deux évènements liés à la sœur viendront dérégler la mécanique du désir voyeuriste et solitaire, provoquant l’agression de la sœur puis le meurtre de Mme Yamabé. D’une part, l’irruption du dehors sous la forme d’un jeune homme qui rapporte le sac à main oublié par la sœur, et la découverte que celle-ci n’est plus vierge. D’autre part, une scène de douche, qui n’est pas sans évoquer celle de Psychose, et dont le montage abolit la distance entre le voyeur et son objet : Makato épie sa sœur qui se douche et alors que, du point de vue de l’espace réaliste, derrière la vitre il ne peut pas avoir vu, une suite de plans subjectifs en contre-champs sur le corps nu de la sœur suggère l’inverse. Mathieu Capel analyse ainsi cette séquence :
Cette courte séquence bouleverse ainsi le monde de Makoto. En oblitérant l’espace du vestiaire, elle réduit la distance entre voyeur et épiée. Jusque là, la petite longue-vue lui permettait d’annuler cette distance néanmoins essentielle. Il faut pouvoir rester loin, caché, et l’opportunité de déjouer cet écart nourrit sans nul doute l’acte voyeuriste en en libérant la jouissance – il en garantit aussi l’innocuité. Or, ici, on ne surmonte pas volontairement la distance : c’est la distance qui s’annule d’elle-même. L’espace dès lors ne s’offre plus dans son étendue, mais se contracte brusquement. Et à trop s’approcher le voir le cède fatalement au toucher, l’œil à la main, la masturbation au viol. (3)
Makoto cependant doit se protéger du regard de l’autre, aussi lui est-il nécessaire de bander les yeux de ses victimes. Mais même alors la pénétration s’avère impossible : des légumes servent d’instruments au viol de la sœur, des coups de ciseaux dans la poitrine se substituent à celui de Mme Yamabé.
La participation des Secrets derrière le mur au festival de Berlin en 1965 provoque une fois de plus un scandale, certains japonais s’offusquant de voir un tel film représenter leur pays.
Autre film parlant de la condition féminine, Va, va, vierge pour la deuxième fois, tourné en 1969, qui épouse la structure simple d’un Rape & Revenge. Une jeune fille est violée sur le toit d’un immeuble par une bande de voyous. Un jeune homme a assisté au viol impuissant. Les deux jeunes gens se lient, et le garçon, dont on apprend qu’il a lui-même été violenté, venge la jeune fille en tuant ses agresseurs.
Bien qu’il se déroule en extérieur, sur les toits de la Wakamatsu Production, ce film n’en dégage pas moins une sensation de huis-clos oppressant : les personnages paraissent enfermés dans ce décor unique malgré l’absence de murs. Précédant son ami, la jeune fille trouvera d’ailleurs la mort, son plus grand désir, en se jetant du haut du toit.
Les films de Wakamatsu sont libres dans leur forme autant que dans leurs sujets et s’affranchissent d’une narration classique pour se permettre de nombreuses audaces formelles. Dans ce film notamment, les dialogues et la façon dont ils sont dits, en s’éloignant du quotidien, créent de la poésie. Les mots y trouvent une résonance particulière. La musique baigne le film de son lyrisme, contribuant à l’installer dans un climat non-réaliste. Une certaine langueur émane de cette errance sur les toits, qui ne suit pas vraiment de construction dramatique. Le noir et blanc très stylisé, avec des blancs éclatants, parfois déréalisants, contribue à l’atmosphère onirique. Wakamatsu n’a pas les moyens de tourner ses films sur pellicule couleur, mais l’apparition ponctuelle de la couleur, durant quelques plans seulement, sert d’argument publicitaire aux exploitants. Au-delà de cette dimension commerciale, les passages du noir et blanc à la couleur qu’on retrouve dans de nombreux films sont souvent très beaux. Dans celui-là, la couleur intervient lorsque le garçon amène son amie devant les cadavres des hommes et des femmes qui l’ont violé et qu’il a ensuite assassinés. Elle surgit de manière agressive, le rouge du sang saturé à l’excès, irréaliste, produisant un effet de choc et transformant la scène en vision cauchemardesque. S’ensuit un flash-back, en couleur toujours, qui nous donne à voir le viol collectif subi par le jeune homme, puis une partouze qu’il regarde à distance, puis le meurtre – second rape & revenge à l’intérieur du film. La violence de ces scènes est accrue par la violence et l’artificialité des couleurs vives. Le traitement de ces scènes d’orgie exclut heureusement tout érotisme. La caméra, fixe, filme les corps à une certaine distance, sans participer aux ébats. Les visages satisfaits des hommes et des femmes y sont parfaitement grotesques.
Les contraintes budgétaires n’empêchent pas un bon réalisateur d’avoir des idées. Le style de Wakamatsu se caractérise par ces partis pris de réalisation forts, qui contrebalancent l’aspect fauché de ses films. Quand l’embryon part braconner multiplie les effets : surimpressions, flous, cadrages à l’envers matérialisant la folie du personnage masculin. Ces films relèvent ainsi à la fois d’un cinéma formaliste, au découpage précis et maîtrisé et aux cadres soignés, et d’un cinéma d’exploitation réalisé dans l’urgence, avec les moyens du bord. C’est cette double dimension, le regard aiguisé du cinéaste qui compose ses plans, et cette fièvre qui lui fait enchaîner les tournages dans des conditions toujours précaires, la spontanéité qui en découle, qui en font tout le charme.
Le cinéma de Wakamatsu peut être abordé par de nombreux biais tant il est riche par le nombre des productions, les questions qu’il pose et les genres qu’il aborde. Dans Naked Bullet (1969), Wakamatsu s’attaque au film de yakuza, tout en y injectant une dose de cinéma pink. Shinjuku Mad (1970) est un thriller qui se déroule dans les milieux de la pègre. Running in madness, dying in love (1969) s’apparente à un road-movie et La vierge violente (1969 encore, année la plus prolifique durant laquelle il réalise onze films), avec sa touche un peu surréaliste et son érotisme en plein air, n’est pas sans évoquer le cinéma de Jean Rollin.
Malgré la diversité des sujets et des genres, un même souffle libertaire traverse les films de ce réalisateur qui à travers eux voulait appeler à la révolution, tout en constatant les échecs et les limites des mouvements radicaux. « Mon ennemi, disait-il, c’est tout ce qui incarne le pouvoir et l’autoritarisme. Quand je me trouve face à cela, mon esprit se révolte, ma nature profonde de paysan remonte à la surface. Alors je me mets à chanter tout seul dans mon coin, et quand cela ne me suffit pas, je chante à pleins poumons. Voilà ce qu’est à mon sens mon œuvre cinématographique. Inconsciemment, j’ai fait de tous mes films des hymnes à la révolte. » (4)
Charlotte Cayeux
(1) WAKAMATSU Koji, « Je me souviens », in « Koji Wakamatsu, cinéaste de la révolte », éditions IMHO, p.123
(2) Ibid., p.170/171
(3) CAPEL Mathieu, « Evasion du Japon : cinéma japonais des années 1960 », Les Prairies Ordinaires, p.199
(4) « Koji Wakamatsu, cinéaste de la révolte », op. cit., p.56