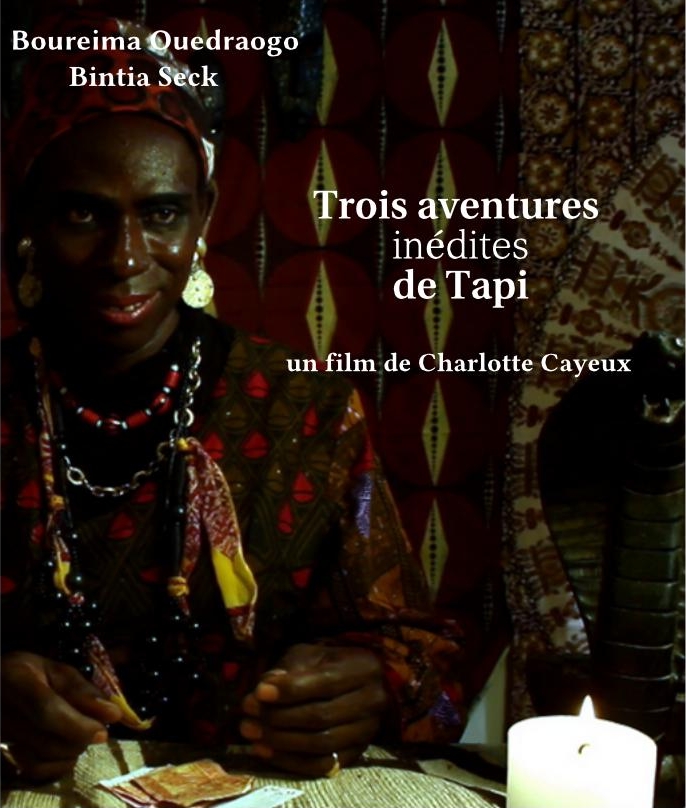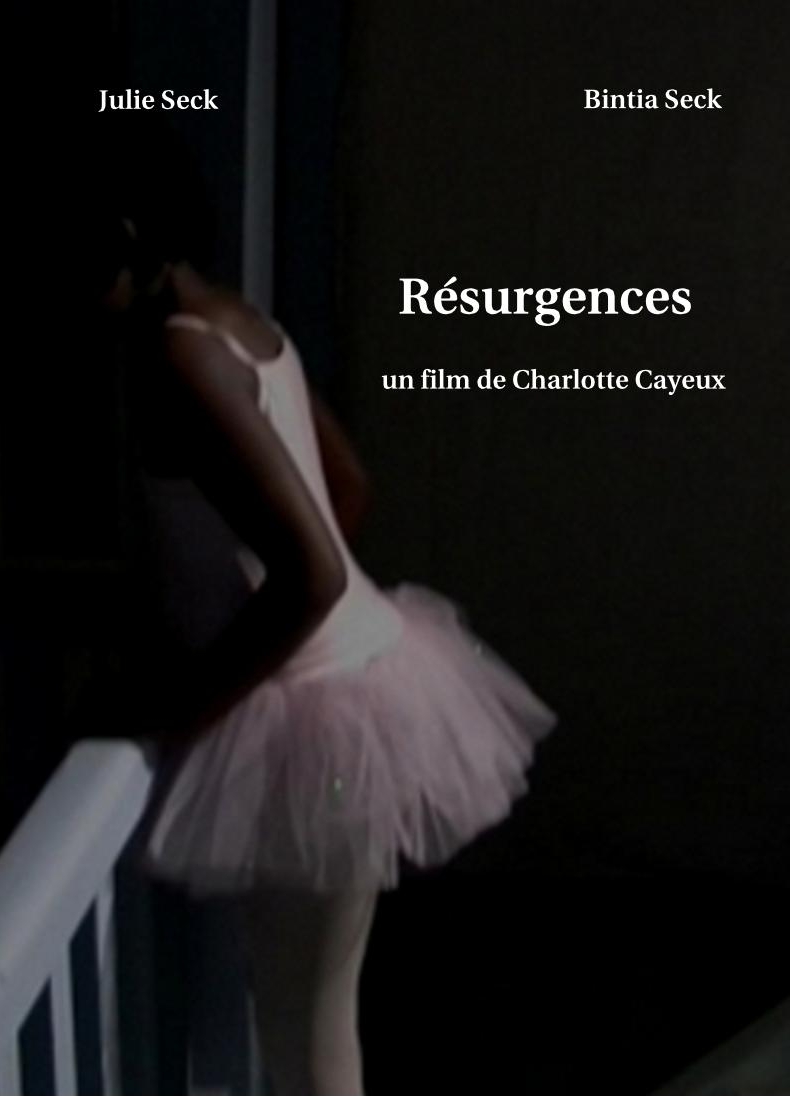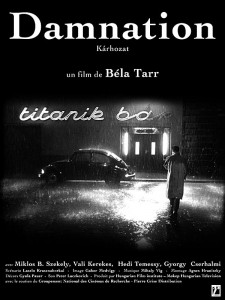Cette nouvelle a reçu le prix Encouragement du concours Brèves de Plume
Matthias s’est réveillé tard. Encore les brumes du sommeil. Des bribes de rêve en mémoire. Fugitives… Il essaie de les saisir, de les fixer. S’accrocher à elles. Mais les images se dissolvent, déjà. Aucune saillie, et tout est mou autour de lui, vague, vaporeux, vaseux.
Et puis, quand il a émergé de tout ce fatras de voiles, il a regardé autour de lui, il a vu les murs blancs, son lit, et c’est tout. Il s’est dit : Je connais cet endroit. C’est la première fois qu’on l’amène ici, il se rappelle avoir senti la peur monter et s’être dit c’est pas possible, on va venir me chercher, c’est une blague, pour me faire peur, un avertissement quoi, pas pour de vrai. Qu’est-ce que j’ai fait ? Me rappelle plus… Tout oublié. Enfin non, y a des visions, des cris qui me reviennent. D’hier. De la soirée. J’étais saoul. Je me suis battu. Avec mon père. Pourquoi ? Je sais même plus. Un truc qu’il a dit qui m’a énervé. Un truc qu’il a dit exprès pour m’énerver. Après, je me souviens plus. Me suis réveillé là. Ce qu’ils ont fait de moi entre temps, ce que j’ai fait, aucune idée.
C’est presque pareil, mais deux ans plus tard. Il a vingt ans.
Sa mémoire engourdie s’est remise en branle peu à peu. Son père : pareil. Des coups : pareil. Pour un motif qui en cachait sûrement un autre, un autre qui n’a pas de mots.
Maintenant il a suffisamment repris conscience et la colère le submerge à nouveau, comme hier, la haine de son père qui fait tout pour lui pourrir la vie !
Et puis après, c’est l’accalmie, le vide qui succède à la violence de ses nerfs, le grand calme qui ressemble à la mort après que la vie a lutté pour rien. Il renonce à toute velléité, se lever, aller se rafraîchir le visage, téléphoner à sa mère pour lui dire de venir le chercher, immédiatement ; il renonce aussi à tout projet plus lointain. Il reste étendu sur le lit blanc, immobile, plus un mouvement, plus rien…
Il y a un tunnel qui n’en finit pas, et je marche – un tunnel aux murs d’un blanc qui éblouit. A un moment, à gauche, il y a une porte. Je l’ouvre et je vois le corps de mon père, inanimé. Je la referme. J’ai un haut-le-coeur. Je reprends ma marche, jusqu’à la prochaine porte. Je l’ouvre, je vois mon cadavre étendu dans la même position que celle de mon père. Je m’avance un peu et je regarde mon visage et la ressemblance avec celui de mon père me frappe ; c’est lui avec trente ans de moins. Je reste effaré par cette révélation. Tout à coup j’entends une voix de femme, la voix de ma mère, douce. Elle appelle, elle nous appelle – elle prononce nos deux prénoms, et je perçois son inquiétude. Elle appelle de plus en plus fort et ça devient un cri rauque dans mes oreilles et je m’éveille en sursaut.
Les paupières s’ouvrent et en face de lui il y a une dame en tenue d’infirmière, qui sourit. Elle lui dit des mots gentils qu’il n’a pas l’air de comprendre et avant de repartir, elle lui fait une piqure, et il boit dans le gobelet qu’elle lui tend. Il se retrouve seul, de nouveau. Les médicaments font effet et il sent une somnolence le reprendre, irrésistiblement. Il ne se rendort pas mais il ne peut pas bouger, une lassitude de tout le corps l’a pris, et une lassitude de l’esprit, qui lui fait renoncer de nouveau à toute tentative de raisonner.
Dans quelques heures, il rencontrera le psychiatre. Il téléphonera à sa mère, pour qu’elle vienne le voir, et qu’elle lui apporte des livres. On l’aura prévenu que cette fois, il est allé trop loin et qu’il faut qu’on le soigne. Qu’il est dangereux pour lui de retrouver sa liberté, maintenant.
Quand Matthias a vu Anaïs, la première fois, il était là depuis un mois. Les journées s’enchaînaient identiques, ou presque – son humeur seule changeait. Parfois la colère sourde, et puis d’autres fois l’apathie. Violents changements. Comme la mer, les marées. Mais globalement, l’engourdissement… l’effet des médicaments. Il lit quand il en a le courage. Sinon rien. Un rien ponctué par les repas, la toilette, les piqûres, et les séances avec le psychiatre. Les visites de sa mère une fois par semaine, pas plus. De temps en temps, la télé dans la salle commune, mais ils regardent que des conneries. Des séries, des films mauvais. Et les patients… tous demeurés ! Sauf un ou deux, avec qui il peut discuter un peu. De choses sérieuses ! Pas des échanges incohérents… Ce que je fous dans cet asile de fous !
Matthias se demande ce qu’il fait là, avec des gens incapables de tenir une conversation, comme cette vieille folle avec son genou : « j’ai un problème psychologique au genou », elle vous répète ça en boucle. Ou bien cet homme qui parle tout seul, de longs monologues, même quand y a personne à côté, quand vous passez devant sa chambre vous pouvez l’entendre encore, qui explique, inlassablement, avec une patience absurde, qu’il a fait la guerre, qu’il a été sacré Empereur, qu’il est un héros, et qu’il a une dulcinée qui l’attend quelque part. Ou bien encore, à l’opposé du bavard intarissable, il y a celui qui ne dit rien, prostré, qui n’est peut-être pas fou, mais que ronge peu à peu son mal-être. Il est conscient, c’est pire, trop conscient pour parler de quoi que ce soit, il n’a rien d’autre à dire que sa douleur, qui ne s’exprime pas, sinon par l’absence, l’absence de mots et de gestes, d’envies.
Quand bien même il y aurait dans l’hôpital des gens avec qui parler, des fous dont la folie n’aurait pas atteint le stade qui rend impossible toute discussion censée, des dépressifs que la dépression n’aurait pas encore complètement abattus, Matthias ne daignerait probablement pas s’adresser à eux. Son amour-propre est meurtri d’être dans un asile, chez les fous, alors qu’il ne l’est pas, lui, fou, qu’il n’est même pas violent d’habitude, qu’il avait toutes les raisons de s’énerver. Il sent qu’il n’a rien à faire là, où l’on anesthésie son cerveau à coups de médicaments, où son esprit s’engourdit à force de ne se nourrir de rien, et ses membres s’atrophient un à un de ne pouvoir s’aventurer au-delà du périmètre de la cour.
Les séances avec le psychiatre le défoulent sur le moment. Mais après, il redevient morose. Quand elle vient le voir, il parle peu à sa mère ; une fois partie, il s’en veut. Jour après jour, ses émotions oscillent entre l’ennui et l’angoisse. Il fait des cauchemars, comme celui de ce cadavre, dont il ne sait pas très bien si c’est le sien ou celui de son père. Le matin, il en garde un goût amer qui s’estompe au fil des heures, pour ne laisser qu’un vide.
Alors le jour où Anaïs traverse la salle commune pour la première fois, c’est un bouleversement. Une nouveauté inespérée. Il s’est rappelé de Marie, à qui il n’avait plus pensé depuis longtemps. Il a eu envie de filles tout à coup. Elle était petite Anaïs, si petite, que ça accentuait l’air qu’elle avait d’être une chose si fragile entre les mains des deux infirmiers qui la tenaient par le bras. Elle avait des couettes, aussi, et un regard vert imbibé de larmes, tellement que Matthias en a eu le cœur fendu. Elle regardait par terre. Elle portait un jean délavé, un peu vieux, et un tee-shirt qui laissait deviner des petits seins, et ça l’a ému.
Elle a traversé la salle vite, traînée par les deux infirmiers. Ça se voyait qu’elle n’était pas là de son plein gré. Matthias a regardé la scène attentivement, pour la première fois depuis son arrivée. Elle est passée devant lui sans le voir et on aurait dit une petite fille chétive, une poupée de chiffon à deux doigts de s’effondrer, telle qu’elle se laissait conduire, sans résistance.
Les jours qui ont suivi, souvent il a eu cette vision d’elle traversant la pièce, les yeux rouges, et il y avait tant de tristesse et de résignation dans ce regard. Il s’est dit qu’il pourrait peut-être la consoler, que ça ne devait pas être si grave, et puis ça l’a énervé de penser qu’ils allaient la garder enfermée elle aussi, elle toute jeune, dix-sept ans peut-être, quel gâchis, elle toute fraîche et les joues roses. Il la croisait quelquefois, dans les couloirs, à la cantine, mais elle ne le voyait pas, le regard toujours vers le sol, qu’elle relevait parfois et dirigeait d’un bout à l’autre de la salle, lentement avant de baisser la tête de nouveau, complètement, comme si la vision de l’hôpital et de ses patients l’avaient achevée, et alors il pouvait voir fugitivement ses yeux se mouiller. Il n’y avait rien de pire que ces larmes qui ne coulaient pas, prisonnières au bord des cils.
Quand Matthias a parlé à Anaïs pour la première fois, il n’avait pas vraiment parlé depuis plusieurs jours. Depuis la visite de sa mère. Il lui avait posé quelques questions, sur la famille, sa petite sœur, il avait fait des efforts, il voulait faire plaisir à sa mère, mais c’était des efforts énormes pour enchaîner deux mots, écouter les réponses, avoir l’air d’aller mieux, de ne pas faire tant d’efforts. Quand elle est partie il était épuisé, il s’est jeté sur le lit et il s’est mis à pleurer, doucement, parce qu’il avait dû se contenir tellement pendant qu’elle était là. Il a pensé : heureusement que personne ne me voie, je ne supporterais pas, je ne supporte déjà pas tout seul, pleurer, comme ça, pour rien, à cause d’un truc qui me noue le ventre sans que je puisse le nommer, un sentiment encore plus impérieux que l’envie de frapper mon père, parfois, de lui faire mal.
Le lendemain, il a vu le psychiatre, et il n’a rien dit, presque rien, il a hoché la tête deux-trois fois et c’est tout. Le psychiatre a dit qu’étant donné l’amélioration de son comportement ces derniers temps, il aurait droit à des sorties journalières, une heure en ville s’il voulait, avec la condition qu’il rentre à l’heure, et qu’il coopère davantage. Personne ne peut vous soigner malgré vous, il a dit, vous devez avoir envie de vous en sortir.
Alors quand il s’est retrouvé à côté d’Anaïs, au réfectoire, le lendemain, il était un peu moins morose. Il se disait : ça s’améliore, avec un peu de chances, bientôt on me laissera sortir. Il allait presque bien et il a eu le courage de parler le premier, de banalités. Ce que cette bouffe était dégueulasse. Elle parlait peu mais elle était gentille, si douce, ça lui en faisait des frissons d’émotion de voir tant de douceur enfermée, confisquée au dehors.
Quand il l’a revue, Anaïs semblait contente aussi, elle souriait même un peu, et ses yeux n’étaient plus mouillés même s’ils gardaient la teinte un peu grise des jours tristes. Alors tous les jours ils se sont parlés, dans la salle commune ou à la cantine, assis l’un à côté de l’autre, ils parlaient de tout et de rien mais, comme d’un accord tacite, surtout pas de l’hôpital, surtout pas de leurs blessures et ce qui les a menés là.
Anaïs a un nouveau corps.
Un corps lisse et souple qu’elle a envie de caresser. Un corps à elle, dont elle ne veut plus se débarrasser, comme d’un vêtement trop lourd, ou d’une peau étrangère.
Elle fait de son corps une barrière entre elle et sa pensée, pour n’être plus que sensations.
C’est étrange cette réconciliation soudaine avec elle-même. Et puis, en même temps, elle sent que ça ne va pas durer, que ça ne peut pas durer, qu’on ne fuit pas son passé. Il y a ces fantômes qui la hantent depuis si longtemps, et qui vont revenir, elle le sait, briser cette harmonie.
Mais en attendant, ne pas trop penser, sentir : les battements de son cœur quand il passe, la vague de chaleur qui l’inonde lorsqu’il s’approche, la sensation d’un souffle voluptueux sur la peau quand elle pense à lui, la nuit. Faire durer le présent.
Monsieur Alain, le psychiatre, a discuté avec le personnel de l’hôpital, avec la direction de l’hôpital, et de ces discussions et de ses propres analyses il a conclu que l’instauration d’une relation trop intime entre Anaïs et Matthias nuirait à la thérapie des deux patients, et qu’en conséquence il fallait de près les surveiller.
Comme le directeur d’une école primaire suit d’un œil sévère et concentré les gestes de deux enfants précoces dans la cour de récréation, il les observe, il leur lance des avertissements, il prend des décisions.
Le jour où l’on retrouve Matthias et Anaïs dans le même lit, enlacés, le psychiatre décide de prendre des mesures radicales.
Matthias se sent comme un adolescent. Elle est là contre lui, et c’est la première fois qu’elle est si près. On dirait que j’ai douze ans.. On dirait la fois où j’ai embrassé ma première petite amie. Dans la rue je l’ai prise par la main, on est allés s’asseoir tous les deux sur un banc. J’étais un dur, pas du genre sentimental, plutôt à me bastonner, et d’être là avec elle et doux, ça me faisait tout drôle, j’étais quelqu’un d’autre. J’en avais comme une gêne, de la pudeur, d’avoir l’air tendre avec elle, et je me disais, heureusement qu’on nous voit pas. Et aujourd’hui à vingt ans, c’est un peu la même chose, un peu les mêmes impressions, et je me dis que rien ne change, parce qu’au fond dans ma vie, rien n’a changé.
Maintenant, je suis là avec elle que je tiens dans mes bras, je suis enfermé parce que je suis dangereux, mais avec elle je suis inoffensif, et je ne crois pas que ma vie va être changée, bouleversée, non, je n’ai pas d’espoir aussi grand, mais la certitude de vivre un moment fugace et beau, une parenthèse.
Parce qu’après, il devra rentrer chez lui. Revoir ses parents, son père, supporter son regard accusateur, ses reproches, ses gestes qui le hérissent. Sa mère, sa tristesse, son impuissance.
Trouver du travail, un appartement. Quitter la maison parentale. Être autonome.
Être autonome.
Matthias reste étendu là sur le lit le corps d’Anaïs contre son corps mais même ainsi il ne peut pas se dégager de l’angoisse.
Quelques jours plus tard, Anaïs traversera de nouveau la salle commune, deux infirmiers la tenant par le bras, cette fois dans l’autre sens, puis la cour de l’hôpital, toujours les infirmiers autour d’elle, et montera dans un véhicule qui la conduira dans un autre hôpital. Elle n’aura pas été prévenue, elle n’aura pas eu le temps de dire au revoir à Matthias ni d’échanger son adresse, elle partira avec la certitude de ne pas le revoir. Il y aura du soleil, un soleil doux de printemps et une brise légère qui caressera ses cheveux et son visage quand elle traversera la cour, et qui rendra le sentiment de l’injustice plus aigu encore. Elle aura envie de crier face à la beauté calme des arbres autour d’elle, des fleurs bien entretenues, indifférentes, mais on n’entendra que les pas sur les graviers, et sur le visage n’apparaîtra qu’un froncement de colère, de colère sans courage. Après le départ du véhicule, rien dans le paysage ne portera la trace de ce drame, comme il ne subsistera rien des multitudes de tragédies humaines qui auront passé par là.
Charlotte Cayeux